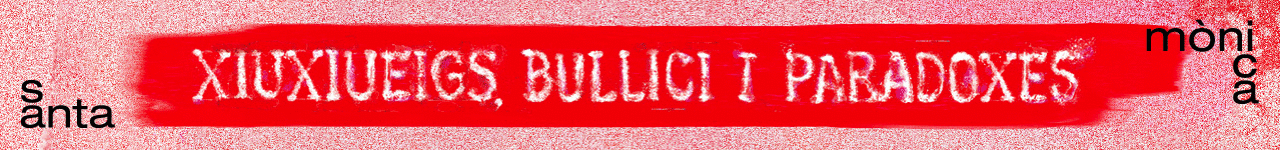Nouvelles
Journée de débat sur le conflit autour des peintures de Sixena
L'Académie royale catalane des beaux-arts de Sant Jordi réunit des experts pour analyser l'avenir et les controverses autour de ce patrimoine.

Le jeudi 26 juin, une conférence sur le problème des peintures murales de Sixena s'est tenue à l'Académie catalane des beaux-arts de Sant Jordi, à l'initiative de son professeur, le Dr Alberto Velasco, organisée par le Congrès de la culture catalane. L'auditorium de l'Académie avait rarement été aussi bondé qu'à cette occasion.
La journée s'est déroulée autour de quatre tables rondes : l'une sur l'art, le patrimoine et les musées, une autre sur la conservation-restauration, la troisième sur les questions juridiques et la dernière sur la presse et la communication. De nombreux points ont été abordés, mais comme il y avait douze intervenants et quatre modérateurs, je ne m'étendrai pas sur les idées émises. De nombreux points ont été abordés, car il ne faut pas se poser en juges des critères du passé. Le sauvetage des œuvres en question a eu lieu à l'été 1936, après le violent incendie iconoclaste, et la décision de sauver ce qui restait a été prise en pleine guerre, dans des circonstances d'alerte et d'urgence extrêmes, et sans réelle possibilité d'agir de manière normative. Les peintures avaient brûlé à une température d'environ 1 000 °C, ce qui a profondément modifié non seulement les couleurs des vestiges, mais aussi l'essence même de la matière qui les constituait.
L'ensemble actuel, conservé en Catalogne depuis près de quatre-vingt-dix ans, ne se résume plus aux tableaux de Sixena, mais à une nouvelle réalité constituée de leurs cendres, arrachées au mur, fixées sur toile et redessinées par leurs restaurateurs dans les nombreuses parties entièrement détruites par un incendie qui, soit dit en passant, n'a suscité en Aragon aucun désir de les sauver. Sans l'action de Josep Gudiol – unanimement reconnue par les participants de la journée – et de son équipe, financée par la Généralité de Catalogne, il n'y aurait aujourd'hui rien à réclamer, car ce qui restait de cet ensemble est resté dans l'obscurité pendant un certain temps après que le plafond qui recouvrait la pièce eut complètement brûlé.
 Jornada 'Les pintures murals de la sala capitular de Sixena: I ara, què', la darrera setmana a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Jornada 'Les pintures murals de la sala capitular de Sixena: I ara, què', la darrera setmana a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Le MNAC a toujours apporté un soin extrême à cet ensemble Sixena. Les peintures peuvent également être examinées de l'arrière, et l'humidité relative de la salle est maintenue à 58/60 °C, favorable au caséinate de calcium, tandis qu'à l'extérieur des salles romanes, l'humidité est plus faible. Avec le transfert en Aragon, 20 % des vestiges des peintures dans leur état actuel pourraient être perdus. Mais la politisation de l'ensemble du processus a fini par empêcher que les critères techniques ne soient imposés au détriment de la volonté politique. Cependant, si une sentence ne peut être techniquement respectée, elle ne doit pas être imposée. Les techniciens aragonais affirment que le climat prévu dans la salle du monastère où les vestiges des peintures reviendront sera le même que celui actuellement en vigueur à Barcelone, mais le projet de remplacement préparé par la partie aragonaise n'a pas été rendu public.
D'autre part, l'actuelle Generalitat n'a déposé aucun recours en protection devant la Cour constitutionnelle, et il ne sera donc pas possible de faire appel à Strasbourg. Il est clair que certaines institutions actuelles sont gênées par le fait que toute cette question soit débattue. Malgré cela, toutes les voies doivent être épuisées, mais chacun sait qu'il en reste très peu. Les journalistes, très combatifs, se sont néanmoins sentis seuls dans cette tâche, et les participants de Lérida, en particulier, ont estimé que l'opposition catalane au départ des pièces s'était accrue, imputant ce phénomène au fait qu'actuellement la « victime » est Barcelone – le MNAC –, alors qu'en 2017, c'était le Musée de Lérida. Et Lérida, ont-ils affirmé, « existe aussi ». Lorsque la Garde civile a confisqué de force l'ancien ensemble de biens aragonais du Musée de Lérida, elle a voulu le mettre en scène de manière impétueuse et impitoyable, alors que la restitution avait déjà été convenue. Et leur prétendue restitution n'était pas telle, puisque ces biens ne retournèrent pas à leurs paroisses d'origine, dans la Franja, mais à un musée, à Barbastro, siège du nouvel évêché résultant de l'amputation de celui de Lleida, où ils n'avaient jamais été auparavant.
Il faut toujours garder à l'esprit que le déclencheur de tout ce problème ramifié, qui a finalement donné lieu à des antagonismes inutiles et logiquement indésirables entre territoires, et qui mettront des siècles à se résorber, a été l'amputation d'un diocèse, celui de Lérida, entre 1995 et 1998 – avec des ségrégations antérieures en 1955 –, une circonstance très grave dont l'évêque a cependant eu connaissance par le journal El Heraldo de Aragón. Il s'agit d'un diocèse qui existait avec ces limites depuis le XIIe siècle, qui existait déjà avant l'invasion musulmane, et qui a été gravement blessé il y a une trentaine d'années sans que l'attaque ne réponde à aucun besoin pastoral ni à la volonté de ses paroissiens.
Si les restes des peintures qui se trouvent aujourd'hui au MNAC finissent par disparaître, scénario qu'aucun des présents à la conférence ne souhaitait, plusieurs intervenants ont déclaré que la salle vidée devrait être utilisée comme un espace de « mémoire », où, tandis que les peintures étaient pratiquement reproduites dans leur apparence d'avant l'incendie, tout ce processus traumatique et ses conséquences politiques seraient expliqués.